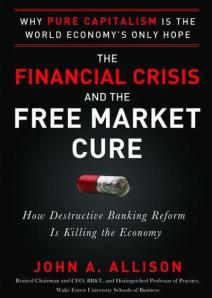L’obsession locale
En plus de mesures pour le bio, la Commission propose plusieurs mesures pour favoriser l’agriculture locale, notamment en soutenant les circuits courts de distribution (la vente par le fermier même; #16-1), la vente de produits locaux aux institutions publique (#16-3) et en formulant des attentes bien précises à la SAQ pour vendre et promouvoir les alcools québécois (#16-4). À première vue, ces propositions semblent alléchantes; elles permettent de trouver des débouchés à l’agriculture du Québec et même de rapprocher les gens des cultivateurs dans le cas des circuits courts. Malheureusement, elles se basent plus sur la passion que sur la raison à plusieurs égards.
Tout d’abord, elles sont teintes de jalousie. Les gens qui tiennent absolument à ce que la production soit locale le font généralement dans une optique protectionniste à peine voilée, comme ces Anglais qui se plaignent « qu’autant » de fruits proviennent de l’Afrique subsaharienne, dont le climat permet de produire plus efficacement (Desrochers et Shimizu, 2012). Est-ce que les Floridiens se plaignent que le Québec ait un avantage dans la production de sirop d’érable, et inversement pour la production d’oranges?
Aussi, elles supposent que la production locale est moins chère. Si tel était le cas, alors la mesure serait totalement inutile. Or, hors de la saison des récoltes (août-octobre), il y a bien peu de fruits et légumes québécois (abordables) sur les tablettes. Doit-on forcer des institutions déjà déficitaires comme les hôpitaux à s’endetter encore plus pour encourager les producteurs locaux? Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’un producteur local? La définition n’est donnée nul part par la Commission. Si importer d’un autre pays n’est pas considéré local, qu’en est-il de l’école de Gaspé qui prend ses légumes de la Montérégie? Ou de ce marchand d’Iqaluit qui prend ses fruits du sud de l’Ontario?
De plus, des groupes comme le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec s’efforcent de maintenir en vie ce qu’on pourrait qualifier de sophisme de l’emploi. La Commission le cite : « l’achat local… favorise la réinjection des investissements dans la communauté et contribue au développement économique de la région et à la création d’emplois » (Pronovost, 2008). Si la création d’emploi est le véritable but du Regroupement, alors il n’a qu’à prendre des méthodes nettement plus simples : creuser un trou afin de stimuler l’économie (Keynes, 1936), décréter une amputation nationale de la main droite, ce qui emploiera nettement plus de monde (Bastiat, 1848) ou, puisqu’il s’intéresse à l’agriculture, encourager le travail dans les champs avec ses mains plutôt qu’avec des outils (Bastiat, 1845). Dans chacun des cas, on stimule effectivement l’emploi, mais est-ce efficace? Non, évidemment : on se donne plus de peine que nécessaire. Le travail vise à éviter cela; il vise à trouver la façon la plus efficace d’arriver à une fin, généralement satisfaire ses besoins. Pourquoi utiliser ses muscles comme Sisyphe quand on peut prendre une grue (Bastiat, 1845)? Si le Regroupement tient véritablement à favoriser le développement économique régional et l’emploi, qu’il plaide plutôt pour laisser les citoyens libre de décider où ils achètent leur nourriture. Ainsi, s’ils réussissent à obtenir le meilleur rapport qualité/prix, ils auront plus d’argent pour autre chose comme l’investissement et ainsi créer une croissance basée sur une véritable demande plutôt que l’argent des autres.
Troisièmement, à l’instar de la plupart des affirmations sur l’agriculture bio, l’agriculture locale ne semble pas survivre à l’épreuve des faits. Ainsi, contrairement aux idées reçues, « faible circulation des produits, économie d’énergie » (Pronovost, 2008), il est proportionnellement moins polluant pour le Canada d’importer sa nourriture d’endroits plus propice à l’agriculture (fusse au niveau des Tropiques) que de produire localement. Ce qui pollue plus dans la chaîne de distribution alimentaire, c’est la production et la vente, surtout quand les températures varient énormément (pour la production de serre) et quand les gens font plusieurs petits voyages en voiture à l’épicerie. Ces derniers éléments polluent plus par tonne de nourriture qu’un bateau cargo bien rempli parcourant 5000 km (Desrochers et Shimizu, 2012). Mais plus important encore, c’est sans doute la pire menace pour la sécurité/souveraineté alimentaire, pour laquelle on invoque tant de protectionnisme. En effet, aucun pays n’a avantage à être « alimentairement » autarcique puisque d’autres pays ont toujours un avantage comparatif pour certaines cultures. Tenter de pousser cette souveraineté peut entraîner des résultats fâcheux, notamment pour l’environnement, comme ce fut le cas avec la canne à sucre en Floride (Usborne, 1994). Se concentrer sur ce qu’on fait de mieux permet ainsi d’éviter de produire ce qu’on peut importer pour moins cher. Les Pays-Bas actuels, au 19e siècle, ne cultivaient presque rien et n’avaient presque aucune famine ni explosion des prix de leurs denrées – et on parle d’une époque où il n’y avait encore que le bateau à voile et presque pas de trains (Say, 1841). La réforme des lois céréales en Angleterre a permis aux Anglais d’importer leur blé d’ailleurs (à meilleur prix), évitant ainsi la famine suite à deux récoltes désastreuses en 1845 et 1846 (Bastiat, 1848). Si les gouvernements avaient écouté le chant des sirènes des agriculteurs et fermé les frontières, la population aurait été décimée. En fait, on voyait déjà à l’époque que renverser la tendance du libéralisme commercial signifierait un grand bond en arrière et une diminution dramatique du niveau de vie. Sans doute parce qu’ils l’ignorent, les « locavores » prônent un retour à l’époque pré-industrielle. À cette époque-là, tout était bio et local… et les gens n’avaient pas une espérance de vie très élevée. Sans compter que la diète était généralement très peu variée et souvent déficiente en vitamines et minéraux (Desrochers et Shimizu, 2012). S’ils veulent vivre ainsi, grand bien leur en fasse. Mais ils n’ont aucun droit de l’imposer à autrui.